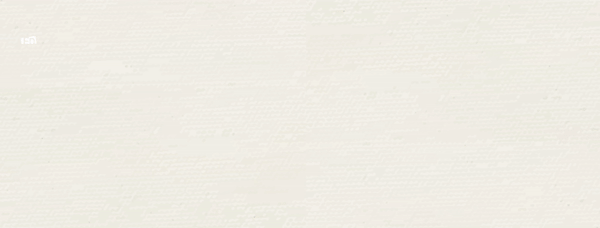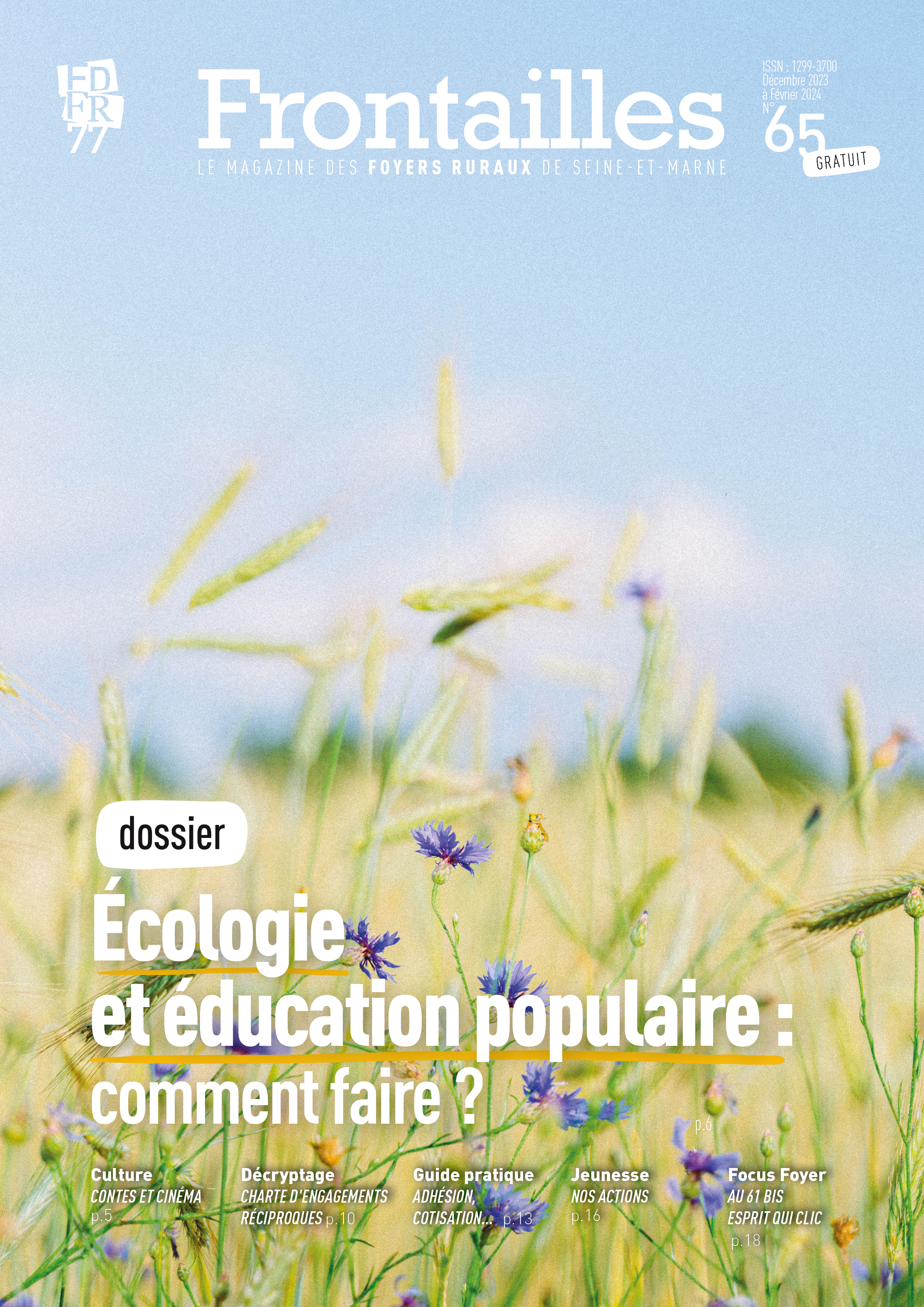Loi 1901, aux origines de la liberté d’association
Pour beaucoup de personnes, y compris parmi les responsables associatifs actuels, la liberté d’association est une évidence. C’est trop vite oublier que celle-ci n’est pas tombée du ciel, mais qu’elle fut l’objet d’un âpre combat qui s’inscrit dans le contexte des luttes sociales du début du XIXème siècle. La loi 1901 est donc une des grandes lois qui garantit les libertés Républicaines au même titre par exemple que la loi 1905 sur la laïcité. Comme toutes les libertés elle n’est jamais acquise définitivement et se doit d’être respectée et défendue par les citoyens et leurs élus.
Les associations existaient avant 1901 sous différentes formes : compagnonnage, communautés religieuses, confréries, etc. au sein desquelles la discipline de groupe s’imposait aux individus. C’est pourquoi, au nom de la défense de la liberté des individus défendue par les révolutionnaires les associations seront interdites suite à la Révolution Française. Selon les révolutionnaires, leur corporatisme représentait un danger pour l’intérêt général et l’Etat.
C’est ainsi que durant tout le 19ème siècle toute forme d’association de plus de 20 personnes est interdite et même criminalisée. Il existait alors un « délit d’association » selon lequel aucune association ne pouvait exister sans autorisation et agrément préalable de l’Etat. La loi dite Le Chapelier interdit en effet toute association ou coalition entre citoyens de même profession. Les syndicats de travailleurs sont donc interdits et les militants se réunissent dans la clandestinité.
« Il est intéressant de constater que les interdictions n’ont jamais réellement freiné le mouvement associatif, les citoyens bravant les interdictions et faisant souvent fi des autorisations préalables pour se réunir… »
Les luttes du mouvement ouvrier alors en plein essor face au développement du capitalisme industriel et ses conséquences sociales, vont amener l’Etat à envisager la gestion des conflits sociaux autrement que par la répression. C’est ainsi qu’en 1884 la loi dite Waldeck Rousseau va autoriser l’existence des syndicats. Le gouvernement d’alors comprend qu’il a plus intérêt à autoriser les syndicats qu’à les réprimer, par crainte d’une nouvelle révolution. La loi
sur les syndicats permet en effet de poser un cadre de discussion. C’est le début de la démocratie sociale. Avant cela les évènements de la Commune de Paris joueront un rôle déterminant dans la reconnaissance des syndicats et des associations (cf. notre encadré sur le sujet).
Il est intéressant de constater que les interdictions n’ont jamais réellement freiné le mouvement associatif, les citoyens bravant les interdictions et faisant souvent fit des autorisations préalables pour se réunir. Les lois syndicales et la loi 1901 ne sont donc qu’une conséquence d’un mouvement de fond auquel le gouvernement va devoir répondre en légiférant. C’est le texte de Waldeck Rousseau, père de la loi créant les syndicats et alors chef de gouvernement qui sera retenu et voté le 1er juillet 1901.
Mais la loi 1901 est aussi un terrain de combats entre ecclésiastiques et laïques. Pour les révolutionnaires, il n’est pas question de redonner forces aux congrégations religieuses. C’est ainsi que la loi 1905 actera la séparation de l’église et de l’Etat et donnera un statut particulier aux associations cultuelles.
C’est entre 1884 et 1905 qu’ont été votées les grandes lois dites « lois de liberté ». La loi 1901 consacre en effet la liberté de s’associer pour les citoyens, mais surtout les possibilités pour les citoyens d’y adhérer ou d’en sortir (au contraire des corporations passées). Elle préserve ainsi la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Par ailleurs, elle autorise le droit de se réunir sans autorisation préalable (la déclaration administrative est seulement nécessaire pour que l’association soit reconnue juridiquement).
« C’est au niveau local que la vie associative trouve tout son sens… et qu’il est important de défendre et faire vivre la liberté associative »
Evidemment cette liberté implique la reconnaissance par les associations des principes républicains : ne pas inciter à la haine raciale, ne pas faire de discrimination, ne pas porter atteinte à l’intégrité du territoire… Sans quoi l’Etat a le pouvoir de les dissoudre.
Nous pensons que c’est au niveau local que la vie associative trouve tout son sens. Les communes constituent l’échelon de base de la vie démocratique. C’est donc à cet échelon qu’il est important de défendre et de faire vivre la liberté associative envisagée comme un moyen de formation et d’engagement citoyen. Pour cela, associations et collectivités doivent poser les conditions d’une coopération dans le souci de servir l’intérêt général.
Aurélien Boutet, directeur de la FDFR77
 Il y a 150 ans, la Commune de Paris
Il y a 150 ans, la Commune de Paris
La Commune de Paris est un évènement peu connu (peu abordé à l’école) mais qui va pourtant avoir un impact majeur quant à la promulgation des lois de liberté.
Rappelons les faits. Ils se déroulent entre mars et mai 1871. Le peuple de Paris se soulève pour marquer son opposition à la capitulation devant la Prusse. Les parisiens décident alors de reprendre leur destin en main. Organisant une forme de démocratie directe (qui se passe de représentant) les insurgés vont mettre en œuvre un programme révolutionnaire : séparation de l’Eglise et de l’Etat, école gratuite et obligatoire, égalité salariale hommes-femmes, liberté d’association, gestion des entreprises par les salariés…
Mais cet élan de liberté et ce qu’on nommerait aujourd’hui « expérimentation sociale et démocratique » sera écrasé dans le sang par le gouvernement d’Adolphe Thiers. Plus de 25000 parisiens sont tués, d’autres sont arrêtés ou déportés. Il n’en reste pas moins que l’esprit de la Commune raisonnera encore longtemps (et raisonne encore à ce jour) dans l’esprit du peuple comme une forme d’utopie qui aura donné naissance à de nombreuses conquêtes sociales et républicaines.
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/fdfrzajo/www/site2015/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184